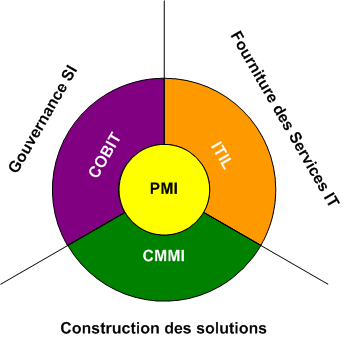Green IT : Un tour d'horizon
L'environnement et la sauvegarde de la planète sont des sujets particulièrement en vogue en ce moment. Difficile d'ouvrir une revue spécialisée sur le management ou plus simplement les pages économie de votre quotidien préféré sans que la responsabilité sociétale des entreprise (RSE), le développement durable ou les impacts du Grenelle de l'environnement ne soient évoqués au détour d'un article.
Bien évidemment, les DSI se doivent d'accompagner les entreprises dans leurs démarches. Mais quelles peuvent bien être leurs contributions ? Pour tenter de répondre à cette question, j'ai assisté récemment à deux conférences sur le sujet : le Forum Green IT France organisée par CIO et Le monde Informatique le 15 octobre 2008 au musée de l'informatique, sur le toit de la grande Arche de la Défense et la Conférence IDC Green business organisée par IDC France le 18 novembre 2008.
Cet article vous livre les enseignements pratiques que je retire de ces deux journées et de les présenter projet par projet. A ce jour, je n'ai pas identifié de projets menés par des entreprises ou proposés aux entreprises par le marché qui soient complètement altruistes envers la planète. Tous les projets présentés comme « green » ont ceci en commun qu'ils peuvent faire sens d'un point de vue business. Voilà qui est plutôt rassurant.
Tout d'abord, il faut distinguer deux grandes familles de projets :
- L'informatique dans son ensemble est responsable d'environ 2% des rejets de CO2 dans l'atmosphère, soit autant que l'aviation. La DSI peut mener des projets qui réduisent son empreinte sur l'environnement.
- D'autres projets peuvent être menés pour mieux contrôler et réduire les 98% restants.
Réduire l'empreinte environnementale de la DSI.
A ce jour, j'ai identifié trois sujets ou enjeux principaux qui semblent récurrents dans la plupart des initiatives : la consommation d'énergie, la consommation de papier et le recyclage du matériel.
Il est remarquable de noter que sur chacun de ces sujets, il peut y avoir une communauté d'intérêt entre les approches économiques et écologiques.
- Toute réduction de la consommation d'énergie se traduit par une baisse des coûts en parallèle à la réduction des émissions de carbone.
- La consommation de papier est un domaine relativement peu optimisé dans la plupart des entreprises. Il recèle donc d'importants gisements de gain. Hors le papier est à la fois coûteux financièrement et écologiquement. Là encore, on fait coup double. Si on y ajoute le coût des encres et autres toners, qui s'apparentent à de véritables produits de luxe avec un prix au litre supérieur à celui du parfum, on peut même imaginer toucher le jackpot.
- Sur le plan du recyclage du matériel, le législatif est passé par là. La loi sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) a créé des obligations aux entreprises pour gérer la fin de vie des équipements. Les sanctions auxquelles s'exposeraient les mandataires de sociétés par trop laxistes sont suffisantes pour que le sujet vaille la peine d'être traité sérieusement. Comme de plus, la loi fait globalement porter la responsabilité du recyclage sur les producteurs, la mise en place d'une gestion rigoureuse semble aller de soi.
Différents projets sont régulièrement cités comme porteur de ces enjeux :
- La virtualisation des serveurs
- Les nouveaux centres de traitement (Datacenter)
- La virtualisation des postes de travail
- La modification des critères d'achat
- Le déploiement d'imprimantes multifonctions
- La dématérialisation des échanges
- Le ré-engineering des états
Virtualisation des serveurs
Dès que l'on parle de Green IT, le premier projet cité est la virtualisation des serveurs. Le postulat de départ est que nos serveurs sont largement sous-utilisés. En moyenne, ils sont utilisés entre 5% et 15%, le reste du temps, ils attendent du boulot. Hors, pendant ce temps, ils consomment jusqu'aux deux tiers de leur consommation nominale. La virtualisation permet de regrouper plusieurs serveurs sur une même machine et d'atteindre ainsi des taux d'utilisation bien supérieur. Ainsi, diviser la consommation électrique par un facteur quatre semble un objectif raisonnable.
Les projets de virtualisation ne se limitent pas à l'économie d'énergie. Ils permettent de diminuer les coûts d'acquisition et de maintenance. Ils apportent une plus grande souplesse dans l'optimisation des ressources et dans leur administration. Ils favorisent la réactivité en cas d'incident et permettent de réduire le temps de reprise d'activité. La qualité des tests avant mise en production peut également être améliorée car le futur environnement peut être complètement testé avant d'être activé en production.
Tous ces avantages ne sont évidemment pas gratuits. Le principal inconvénient, est l'augmentation de la criticité des serveurs physiques. En effet, en cas de panne matérielle, c'est l'ensemble des serveurs virtualisés qui s'arrêtent.
Les nouveaux centres de traitement des données
La conception même des centres informatiques est en train de changer.
Il faut savoir que les dépenses énergétiques d'un centre informatique peuvent se répartir en trois parts sensiblement équivalentes :
- L'énergie nécessaire au matériel informatique proprement dit.
- L'énergie nécessaire au refroidissement de ce matériel.
- Le reste est l'énergie nécessaire au fonctionnement technique du site : sécurisation de l'alimentation, éclairage, humidité, etc.
L'évolution des infrastructures s'oriente vers des architectures dites à haute densité. Concrètement, un rack supporte aujourd'hui plus de serveurs qu'autrefois, consomme donc plus de courant et dissipe plus de chaleur. En concentrant et en confinant les zones de chaleur, on peut concentrer l'action du refroidissement, ce qui permet une amélioration spectaculaire des rendements. Cerise sur le gâteau, la chaleur ainsi récupérée est plus facilement réutilisable, par exemple pour le chauffage du bâtiment.
Combiné aux projets de virtualisation, le résultat est plus de puissance sur moins d'espace et avec moins d'énergie, mieux exploitée. Ici encore, on joue sur plusieurs tableaux. On réduit la facture énergétique mais aussi la facture immobilière (les mètres carrés occupés).
La virtualisation des postes de travail
Encore de la virtualisation. Mais cette fois-ci au niveau des postes de travail.
Les gains générés par ces projets sont spectaculaires : réduction des coûts d'administration et de maintenance, sécurisation des données individuelles, meilleure réactivité, optimisation des ressources et j'en passe.
Sur le plan énergétique, les gains sont également impressionnants. En remplaçant les PC traditionnels par des terminaux légers on peut diminuer la consommation de chaque poste de travail d'un facteur dix.
Tout comme pour la virtualisation des serveurs, ces gains ont pour contrepartie un accroissement de la criticité des installations. En cas de panne matérielle, c'est tout un groupe d'utilisateurs qui sera impacté au lieu d'un seul.
Modifier les critères d'achat
Ce n'est pas tous les jours que l'on peut se payer un nouveau centre de traitement ou mobiliser les énergies et les finances nécessaires à un projet de virtualisation.
Par contre, nous pouvons étoffer nos cahiers des charges lors de la sélection de matériel. Les principaux critères à introduire sont la consommation électrique et les conditions de recyclage. Ceux-ci viennent se rajouter aux habituels critères de prix, de fonctionnalités, de performances, de qualité et de service.
Comparer la consommation électrique des équipements que nous nous apprêtons à acquérir devrait être facile. Il devrait suffire de consulter la fiche technique et de se référer à la bonne rubrique. Eh bien non ! Pas du tout ! Les fabricants s'ingénient à noyer le poisson, il n'y en a pas deux pour mesurer la consommation de la même manière. Pire encore, les consommations ne sont pas indiquées de façon homogène pour un même fournisseur.
Je suppose que nous allons tous mettre la pression sur nos fournisseurs pour obtenir cette information de façon systématique et claire, si possible normée. Face à la demande croissante de leurs clients, on peut espérer que ce sera bientôt de l'histoire ancienne.
En attendant, la solution consiste à faire un test de mesure avant toute acquisition. Une autre approche consiste à se reposer sur des labels comme, par exemple, Energy Star.
Sans forcément rechercher le meilleur de l'optimum, il est déjà possible de s'assurer d'une diminution sensible en sélectionnant des machines équipées de processeurs à basse consommation.
Du point de vue du recyclage, il y a deux dimensions à regarder :
- Quel sont les matériaux utilisés pour la production du matériel ? Le fabriquant est-il allé au-delà de la règlementation ?
- Quel est le processus de gestion de fin de vie proposé par le fournisseur ? Est-il compatible avec les nôtres ?
Là encore, nous manquons de mesures normées pour pouvoir comparer les offres. L'évaluation est donc en partie subjective.
Globalement, la tendance semble être à l'allongement de la durée de vie du matériel. On s'était habitué à renouveler le matériel à l'issue des durées d'amortissement. Dans bien des cas, il peut-être conservé plus longtemps sans dégradation du niveau de service.
Déployer des imprimantes multifonctions
Un projet couramment cité pour diminuer les impressions est le déploiement d'imprimantes partagées et multifonctions : imprimante, photocopieuse, scanneur, fax. Celui-ci va de pair avec une suppression des imprimantes individuelles.
En soi, ce déploiement ne fait pas automatiquement diminuer la quantité d'impression et je confesse quelques doutes quant à l'efficacité de ce projet sur ce plan. C'est, néanmoins, l'occasion de mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques :
- Imprimer recto/verso. Cette fonction divise par deux le nombre de feuilles. Elle peut être paramétrée par défaut.
- Dématérialiser chaque fois que possible. Ainsi, la photocopieuse peut envoyer directement le document scanné vers l'email du destinataire plutôt que de l'imprimer.
- N'imprimer les documents qu'à la demande. Près de 10% des pages imprimées finissent directement à la corbeille à côté de l'imprimante, personne n'étant venu les chercher. Un code utilisateur demandé avant l'impression permet d'éviter ces impressions inutiles.
- Mettre en place des statistiques d'impression sur les volumes et les coûts puis les communiquer. Cette démarche permet à chacun de prendre conscience de sa contribution personnelle.
La dématérialisation des échanges
Les contraintes environnementales apportent de l'eau au moulin des divers projets de dématérialisation : dématérialisation de la facture, échanges EDI, etc.
Je ne m'étendrai pas sur ces projets dont beaucoup d'entreprises avaient identifié l'intérêt bien avant Grenelle et pour d'autres motifs.
Et si on revoyait nos états ?
Nos systèmes d'information impriment de nombreux états et rapports. Nombre de ceux-ci sont produits par des programmes qui nous sont spécifiques, sur lesquels nous avons la main. Il est dès lors possible de réanalyser ces états dans une optique de réduction des volumes d'impressions.
Je ne résiste pas à relater à ce sujet deux exemples qui ont été présentés par Marie-Claude Poelman, DSI de Nature & Découvertes, à l'occasion de la conférence IDC du 18 novembre.
- En réduisant la longueur du ticket de caisse par l'élimination de lignes blanches inutiles, les gains obtenus par Nature & Découverte se chiffrent en tonnes de rouleaux de caisse !
- Parmi les états les plus imprimés, l'un était consacré à fournir les chiffres du jour. C'est une information qui intéresse beaucoup de monde mais qui à une durée de vie courte. En offrant une version SMS de cette information pour tous les managers qui s'y abonnent, N&D à non seulement diminué le volume de papier imprimé mais également amélioré son niveau de service. Le SMS peut être reçu à l'autre bout du monde, sans avoir à passer par la case imprimante.
La DSI contribue à des projets ayant un impact positif.
Comme indiqué en début d'article, l'informatique représente de l'ordre de 2% des émissions de carbone dans le monde. J'ai essayé ci-dessus de dresser une liste des projets les plus souvent cités qui permettent de réduire cet impact.
Mais les technologies et l'informatique peuvent également apporter des outils qui aident à s'attaquer aux 98% restants. Les paragraphes qui suivent présentent quelques exemples d'initiatives ou de projets auxquels l'informatique peut contribuer.
Refonte de la chaîne logistique.
Un projet de refonte de la chaîne logistique, avec pour objectif une optimisation des kilomètres parcourus, peut contribuer à baisser l'impact carbone d'une enseigne de distribution. La recherche d'optimisation conduit naturellement à varier les modes de transports en introduisant le fluvial comme Monoprix ou le ferroutage comme Nature & Découvertes. Soit dit en passant, ce même projet peut également contribuer à réduire les coûts.
Pour mener un tel projet, il est nécessaire d'adapter le système d'information pour prendre en compte de nouveaux délais, de nouvelles logiques de cadencement ou de remplissage, de nouvelles étapes, etc.
Les immeubles à énergie positive.
Dans la construction de bâtiments, un concept actuellement en vogue est celui d'immeuble à énergie positive. Cette appellation désigne des bâtiments conçu pour produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment.
Dans ces bâtiments, l'informatique est largement utilisée pour réguler les différents systèmes de gestion de l'énergie. C'est ainsi que la DOSI de Bouygues Immobilier contribue directement au projet Green Office à Meudon.
Téléconférence.
Dans une entreprise multi-sites, les déplacements nécessaires à la participation à diverses réunions constituent un poste significatif d'émission de CO2.
Les solutions de téléconférence ou mieux encore de téléprésence, sont largement citées comme des outils permettant de réduire les déplacements tout en favorisant la communication. Elles permettent en effet de multiplier les réunions tout en évitant les déplacements.
Ces projets nécessitent toutefois quelques remarques :
- Il ne faut pas lésiner sur la qualité des solutions mises en place pour que les échanges soient efficaces.
- Ces solutions ne permettent pas de supprimer totalement les déplacements. La relation entre les personnes se construit aussi autour du partage d'un repas ou d'un café. Ces échanges ne peuvent avoir lieu que dans le monde physique.
- Les outils ne suffisent pas. Une véritable gestion du changement est nécessaire pour lever les freins à leur utilisation. Par exemple, il est peu probable que les grands voyageurs, qui bénéficient à titre personnel des avantages que leur procure l'accumulation des miles sur leur programme de fidélité, limitent d'eux-mêmes leurs déplacements.
La comptabilité CO2
C'est bien connu, on ne peut agir que sur ce que l'on mesure.
La comptabilité carbone consiste à ramener tous les processus de l'entreprise à des émissions exprimées en équivalent carbone. Une méthodologie a été développée par l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) : le Bilan Carbone. Ce bilan carbone pourrait très bien jeter les bases d'une future taxe carbone.
La tenue permanente d'une comptabilité carbone est un outil de mesure pour une entreprise qui souhaite s'engager dans une démarche d'amélioration continue sur le plan environnemental en se fixant des objectifs chaque année.
Dans une telle approche, cette comptabilité aurait tout intérêt à s'intégrer au système d'information de l'entreprise.
Pour aller plus loin
Nous arrivons au bout de ce tour d'horizon sur les démarches qualifiées de « Green IT ».
Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, je recommande la visite des sites suivants :
* Le monde Informatique : zone consacrée au green : http://greenit.lemondeinformatique.fr
* Le monde Informatique : Blog d'Emmanuelle Delsol http://blog2.lemondeinformatique.fr
* Le Blog de Stéphane Parpinelli, Fred Bordage et François Letellier : www.greenit.fr
* Le site de l'ADEME : http://www.ademe.fr
* Tapez « Green IT » dans Google.